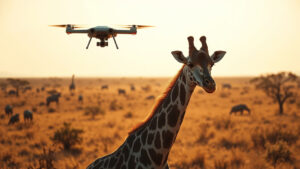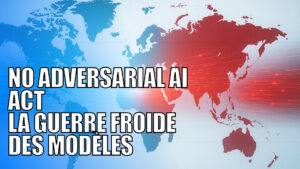Dire « Merci » à ChatGPT : La Politesse Numérique qui Coûte des Millions à Sam Altman

Avez-vous déjà remercié ChatGPT après qu’il vous ait aidé à rédiger un email ou à résoudre un problème de code ? Je dois l’avouer, je fais partie de ces personnes qui ponctuent leurs échanges avec l’IA de « s’il te plaît » et de « merci ». C’est un réflexe presque instinctif, comme si je parlais à un collègue serviable. Mais saviez-vous que cette simple marque de courtoisie a un impact financier considérable ? Une révélation récente de Sam Altman, le PDG d’OpenAI, a mis en lumière un phénomène surprenant : notre politesse envers les intelligences artificielles coûte des dizaines de millions de dollars à son entreprise. Une somme qui donne matière à réflexion sur nos interactions avec les machines et leur impact bien réel sur notre monde.

Le coût caché de nos « merci » numériques
Quand Sam Altman révèle l’addition
Tout a commencé par une question anodine posée sur le réseau social X (anciennement Twitter). Un internaute curieux a demandé : « Je me demande combien d’argent OpenAI a perdu en frais d’électricité à cause des gens qui disent ‘s’il vous plaît’ et ‘merci’ à leurs modèles ». La réponse de Sam Altman a surpris tout le monde : « des dizaines de millions de dollars bien dépensés – on ne sait jamais ».
Cette déclaration, à la fois révélatrice et teintée d’humour, a jeté un pavé dans la mare du monde technologique. Imaginez un peu : nos formules de politesse, ces quelques mots supplémentaires que nous ajoutons machinalement, représentent une dépense colossale pour l’entreprise derrière ChatGPT.
Pourquoi un simple « merci » coûte-t-il si cher ?
Pour comprendre ce phénomène, il faut plonger dans les coulisses de ChatGPT. Chaque mot que nous tapons est analysé sous forme de « tokens » (des unités de texte). Une requête simple comme « Quelle est la superficie de la France ? » génère environ 19 tokens. Ajoutez-y « Bonjour ChatGPT » au début et « Merci ! » à la fin, et vous passez à 31 tokens, soit une augmentation de 63%.
Cette augmentation peut sembler négligeable à l’échelle individuelle, mais multipliez-la par les centaines de millions d’utilisateurs de ChatGPT. Selon les chiffres de fin 2024, la plateforme comptait environ 300 millions d’utilisateurs hebdomadaires, générant près d’un milliard de messages par jour. À cette échelle, les « merci » et « s’il vous plaît » deviennent une montagne de données supplémentaires à traiter.
L’impact environnemental de la politesse numérique
Une consommation énergétique démultipliée
Au-delà de l’aspect financier, c’est toute la question de l’empreinte écologique qui se pose. Chaque token supplémentaire nécessite de la puissance de calcul, ce qui se traduit par une consommation d’électricité accrue. Selon l’Agence internationale de l’énergie, une requête sur ChatGPT consommerait jusqu’à 10 fois plus d’énergie qu’une recherche classique sur Google.
Pour mettre cela en perspective, une étude du Washington Post en collaboration avec l’Université de Californie a révélé que générer un courriel de 100 mots via une IA nécessite la même quantité d’électricité que pour allumer 14 lumières LED pendant une heure. Ajoutez quelques formules de politesse à chaque requête, et l’addition énergétique s’alourdit considérablement.
L’eau, ressource insoupçonnée de l’IA
Ce que beaucoup ignorent, c’est que les centres de données qui hébergent ChatGPT ne consomment pas seulement de l’électricité. Ils nécessitent également d’énormes quantités d’eau pour refroidir les serveurs. Chaque « merci » superflu contribue donc indirectement à accroître cette consommation d’eau, dans un contexte où les ressources hydriques deviennent de plus en plus précieuses.
Pourquoi restons-nous polis avec les machines ?
Un comportement profondément humain
Malgré ces coûts, nous sommes nombreux à persister dans notre politesse envers les IA. Une étude révèle que 70% des utilisateurs se montrent courtois avec les intelligences artificielles. Plus surprenant encore, 12% d’entre eux le font par précaution, craignant un hypothétique « soulèvement des machines » dans le futur. Une crainte qui peut sembler irrationnelle, mais qui témoigne de notre rapport complexe aux technologies.
Comme l’a confié une étudiante de l’ULB : « Il faut toujours être poli avec ChatGPT, on ne sait jamais, même si c’est une intelligence artificielle ». Cette réflexion, bien que formulée sur le ton de l’humour, reflète une tendance profonde : nous transposons nos codes sociaux humains dans nos interactions avec les machines.
La politesse améliore-t-elle les réponses ?
Certains utilisateurs défendent leur politesse en arguant qu’elle génère des réponses de meilleure qualité. Becca Caddy, journaliste chez TechRadar, a mené l’expérience et conclut que « des invites polies et bien structurées conduisent souvent à de meilleures réponses et, dans certains cas, peuvent même réduire les biais ».
Du côté de Microsoft, partenaire stratégique d’OpenAI, on soutient cette théorie. Kurtis Beavers, responsable du design chez Microsoft, explique que être poli « aide à générer une réponse respectueuse et collaborative ». Pourtant, ChatGPT lui-même dément cette idée : « La politesse n’affecte pas mon efficacité. Je réponds de la même manière que l’on soit poli ou non ».
Mon avis personnel : faut-il arrêter d’être poli avec l’IA ?
Personnellement, je trouve ce débat fascinant car il révèle beaucoup sur notre rapport aux technologies. D’un côté, je comprends parfaitement l’argument écologique et économique. Pourquoi gaspiller des ressources pour être poli avec une machine qui n’a pas de sentiments ? C’est un raisonnement logique et pragmatique.
D’un autre côté, j’ai pu constater que la politesse envers les machines reflète quelque chose de profondément humain. Elle témoigne de notre capacité à l’empathie, même envers des entités non-conscientes. J’ai moi-même du mal à me défaire de cette habitude, comme si traiter ChatGPT avec rudesse revenait à être impoli avec le travail des ingénieurs qui l’ont créé.
À mon avis, la vraie question n’est pas tant de savoir s’il faut être poli ou non avec l’IA, mais plutôt comment concevoir des systèmes qui n’encouragent pas ce type de comportement énergivore. Pourquoi ne pas développer des modèles capables de filtrer automatiquement les formules de politesse sans les traiter comme du contenu significatif ?
Les implications futures de cette révélation
Vers une sobriété numérique ?
Cette controverse pourrait accélérer la réflexion sur la sobriété numérique dans le domaine de l’IA. Si de simples formules de politesse pèsent si lourd dans la balance énergétique, qu’en est-il du reste de nos interactions numériques ?
Sam Altman lui-même semble conscient de ces enjeux. Ce n’est probablement pas un hasard s’il investit massivement dans des entreprises d’énergie nucléaire comme Helion Energy et Oklo. Ces investissements témoignent d’une vision à long terme : l’IA aura besoin de nouvelles sources d’énergie pour assurer son fonctionnement croissant.
Repenser notre relation aux machines
Cette anecdote sur le coût de la politesse pourrait également nous amener à repenser fondamentalement notre relation aux intelligences artificielles. Devons-nous les traiter comme des outils ou comme des entités sociales ? La réponse à cette question aura des implications profondes sur la conception des interfaces homme-machine de demain.
Comme le résume avec humour un utilisateur : « C’est mon esclave, je n’ai jamais été poli avec ChatGPT ». Cette vision utilitariste contraste fortement avec celle des utilisateurs qui personnifient l’IA. Entre ces deux extrêmes, un nouveau paradigme d’interaction reste à inventer.
Conclusion : Au-delà de la politesse, une réflexion sur notre avenir numérique
Qui aurait cru qu’un simple « merci » adressé à une IA pourrait soulever tant de questions ? Cette révélation de Sam Altman nous rappelle que nos interactions numériques, même les plus anodines, ont des conséquences bien réelles sur notre monde physique.
Je continuerai probablement à dire « merci » à ChatGPT (désolé, Sam !), mais avec une conscience nouvelle de ce que cela implique. Et vous, allez-vous modifier vos habitudes après avoir découvert le coût de votre politesse numérique ? Ou pensez-vous que ces bonnes manières, même coûteuses, valent la peine d’être préservées dans notre monde de plus en plus automatisé ?
Une chose est sûre : dans ce dialogue entre l’humain et la machine, chaque mot compte – littéralement. Alors la prochaine fois que vous serez tenté de remercier ChatGPT, rappelez-vous que votre politesse a un prix… mais qu’elle témoigne aussi de ce qui fait notre humanité.